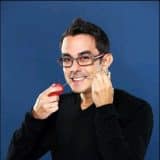Voir le sommaire Ne plus voir le sommaire
La France a toujours porté une forte tradition de protection et d’aides sociales. Pourtant, un phénomène freine aujourd’hui la bonne marche de cette solidarité : le non-recours aux droits.
Aides sociales : le non-recours est un manque à gagner
Ce phénomène de non-recours aux aides sociales désigne les situations où des personnes éligibles à des aides sociales ne les sollicitent pas, volontairement ou non. Et les chiffres sont frappants : pour certaines prestations, jusqu’à 40 % des bénéficiaires potentiels ne font pas valoir leurs droits.
Cette réalité préoccupante prive des milliers d’individus d’un soutien crucial et affecte la cohésion sociale dans son ensemble. Les raisons de ce non-recours sont multiples.
Beaucoup ignorent simplement l’existence des aides ou ne savent pas qu’ils y ont droit. D’autres sont découragés par la complexité des démarches administratives ou craignent d’être stigmatisés en demandant une aide.
Parfois même, ce sont les agents des organismes sociaux eux-mêmes qui ne proposent pas certaines aides. Par méconnaissance ou par jugement sur la situation des personnes.
Face à cette situation, les pouvoirs publics commencent à prendre la mesure de cet enjeu. Le non-recours représente un défi majeur pour réduire la pauvreté, freiner l’aggravation des inégalités. Et assurer une gestion efficace des ressources sociales.
À lireAides sociales : comment vérifier ses droits en quelques clicsCe phénomène touche de nombreuses prestations versées par des organismes comme la CAF, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou Pôle Emploi. Qu’il s’agisse d’aides financières telles que le RSA ou la prime d’activité, ou d’aides non financières comme certains services à la personne.
Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Par exemple, une personne aux revenus modestes qui paie une mutuelle santé pourrait bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire, mais ne la demande pas, se trouve donc ainsi en situation de non-recours. L’ODENORE, créé en 2003, analyse ce phénomène depuis plus de vingt ans.
Sous la direction de Philippe Warin, chercheur au CNRS, ses études permettent de mieux comprendre l’ampleur et la diversité des situations de non-recours. Les chiffres sont édifiants.
Le taux de non-recours au RSA, qui assure un revenu minimum, s’élevait en 2016 à environ 36 %. Et il restait proche de 34 % en 2018. Pour l’ancienne Aide Complémentaire Santé (ACS), il atteignait entre 57 % et 70 %.
Tandis que la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), désormais intégrée dans la Complémentaire Santé Solidaire, connaissait un non-recours situé entre 21 % et 34 %. La prime d’activité, destinée aux travailleurs à faibles revenus, affiche elle aussi un taux élevé, à près de 27 %.
Même des aides attribuées automatiquement, comme le chèque énergie, enregistrent un taux de non-recours autour de 20 %. En 2016, la CAF a mené plus de 250 000 « rendez-vous des droits », des entretiens personnalisés permettant de faire le point sur la situation sociale des personnes.
Et 63 % des bénéficiaires ont pu accéder à au moins une aide grâce à ce dispositif. Cela montre donc qu’un accompagnement adapté peut ainsi faire toute la différence.
Aides sociales : les raisons du non-recours
Cependant, le non-recours peut aussi prendre la forme d’un arrêt injustifié des aides, souvent lié à des erreurs ou des retards dans les déclarations. Ce qui prive à tort des bénéficiaires d’un soutien dont ils devraient bénéficier.
Les causes du non-recours sont aujourd’hui bien identifiées. Une partie des personnes concernées ignore l’existence des aides, ne comprend pas leur fonctionnement ou pense à tort qu’elles ne sont pas concernées.
Dans certains cas, les aides ne sont pas proposées aux personnes éligibles. Soit parce que les agents sociaux eux-mêmes les ignorent. Soit parce qu’ils estiment que la personne ne remplit pas les conditions.
D’autres personnes, malgré la connaissance de leurs droits, choisissent de ne pas faire la demande, souvent par honte. Mais aussi par découragement ou peur de la stigmatisation.
Cette décision peut aussi se voir motivée par une perception négative des démarches, jugées trop complexes, ou par le sentiment que le bénéfice ne vaut pas l’effort à fournir. Parfois encore, le non-recours découle de difficultés pratiques comme le transport, ou de craintes concernant les conséquences fiscales ou administratives.
À lireAides sociales: pour une personne seule, travailler rapporte plusLe non-recours ne peut donc plus se voir considéré comme un simple dysfonctionnement administratif. C’est un enjeu fondamental pour la société, car il met en lumière les limites du système actuel et questionne la capacité de la République à garantir à chacun un accès effectif à la solidarité.
Pour relever ce défi, il paraît donc indispensable de simplifier les procédures, d’automatiser davantage les droits. D’améliorer l’information et de lutter contre la stigmatisation des bénéficiaires.
Crédit photo © DivertissonsNous
Crédit photo © DivertissonsNous