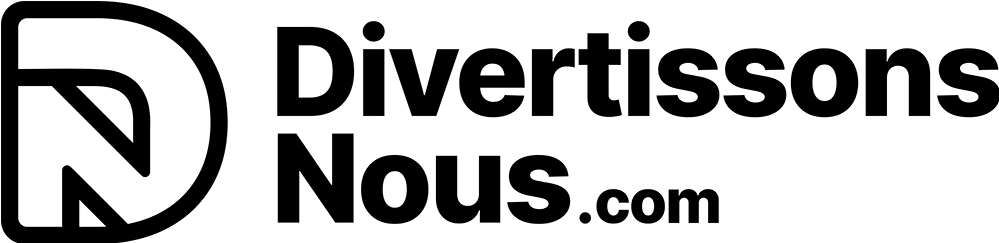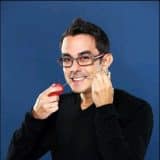Partout en ville, les ralentisseurs cristallisent les discussions. Depuis la récente décision du Conseil d’État, des milliers d’ouvrages se retrouvent sur la sellette. Le gouvernement avance une solution pour les maintenir, mais à quelles conditions ?
Ce que change la décision du Conseil d’État
Au cœur du dossier, l’arrêté technique du 27 mai 1994 encadre strictement les dispositifs surélevés. Le Conseil d’État a rappelé son applicabilité, y compris aux aménagements anciens. Ainsi, des ralentisseurs non conformes ne peuvent rester sans base juridique claire. De plus, les communes doivent justifier chaque ouvrage par un besoin de sécurité avéré.
Concrètement, les juges ont conforté le principe de sécurité juridique. Les textes techniques ne sont pas de simples recommandations. En revanche, la haute juridiction n’interdit pas d’adapter le réseau, si la loi le permet. Les ralentisseurs deviennent donc un sujet de conformité, mais aussi de méthode.
Pourquoi des municipalités s’inquiètent
Les maires craignent de devoir déposer des ouvrages coûteux, parfois récents. Pourtant, beaucoup se situent près d’écoles et de traversées piétonnes sensibles. Dès lors, retirer des ralentisseurs sans alternative ferait peser un risque sur les usagers vulnérables. Aussi, l’équilibre entre sécurité et légalité devient la priorité.
« La sécurité routière ne progresse que si la règle et le terrain avancent ensemble. »
Les collectivités demandent des délais, des guides et des audits. Ainsi, elles veulent hiérarchiser les sites à traiter d’abord. En bref, le but est d’éviter une remise à plat brutale et coûteuse. Les ralentisseurs devront évoluer, mais sans vider les rues de toute modération.
La « parade » gouvernementale en pratique
Selon les éléments rendus publics, l’exécutif travaille à une régularisation encadrée. Désormais, un texte pourrait sécuriser les ouvrages existants, sous conditions de sécurité. Par conséquent, des contrôles de géométrie et de signalisation seraient requis. Les ralentisseurs resteraient en place si la commune documente un intérêt local prouvé.
- Audit rapide des sites sensibles et des abords scolaires
- Mise en cohérence avec la zone 30 quand elle s’applique
- Vérification de la signalisation verticale et horizontale
- Plan de mise en conformité phasé et chiffré
- Concertation publique avec données de vitesse partagées
Le gouvernement veut éviter un retrait massif, jugé impraticable. Ainsi, une période transitoire pourrait s’ouvrir, avec priorités claires. En revanche, un ouvrage dangereux devrait être corrigé sans délai. Les ralentisseurs seraient alors triés entre maintien, adaptation et dépose.
Dos-d’âne — Dos-d’âne (Ralentisseur ; réglementation réglementaire détaillée). Ce profil bombé doit s’inscrire dans une zone 30, avec rampes et marquages conformes, et un drainage efficace.
Des contrôles tiers pourraient appuyer les décisions. D’ailleurs, la traçabilité des choix serait archivée et communicable. Ensuite, un calendrier public apporterait de la visibilité aux riverains. Les ralentisseurs seraient ainsi traités de façon transparente.
Cadre juridique : ce qui reste non négociable
Le respect des normes techniques reste la règle. Pourtant, la proportionnalité s’impose pour chaque site, au regard des risques. Par conséquent, un aménagement jugé excessif doit être revu. Les ralentisseurs n’échappent pas au principe de nécessité de la police de circulation.
À lirePotager en cuisine : cet endroit permet aux citadins de récolter des légumes des semaines avant les autresRalentisseur trapézoïdal — Ralentisseur trapézoïdal (Ralentisseur ; réglementation réglementaire détaillée). Le plateau doit s’inscrire dans la trame urbaine, avec pentes régulées, passages piétons lisibles et signalisation renforcée.
Les voies de secours, de bus ou de transit lourd appellent des solutions adaptées. Ainsi, la chicane, la limitation, ou le radar pédagogique peuvent compléter l’arsenal. En bref, le choix doit reposer sur des données de trafic et d’accidentologie. Les ralentisseurs s’intègrent alors à une stratégie globale, mesurée et traçable.
Quels impacts pour les usagers et les villes
Pour les automobilistes, la lisibilité prime. Ainsi, une signalisation claire réduit les freinages brusques et le bruit. De plus, un profil régulier limite les chocs pour les deux-roues. Les ralentisseurs doivent donc rester prévisibles et cohérents.
Coussin berlinois — Coussin berlinois (Ralentisseur ; hors gabarit). Ce dispositif laisse passer les essieux larges, mais ralentit les voitures, à condition d’un marquage net et d’un bon alignement.
À lireAgirc-Arrco : les retraités perdent jusqu’à 115€, voici le montant à réclamer après cette décision de justicePour les riverains, le confort acoustique compte. Cependant, la vitesse ressentie pèse tout autant sur la sécurité des enfants. Par conséquent, les communes cherchent le juste milieu entre bruit et modération. Les ralentisseurs sont alors ajustés au cas par cas, quartier par quartier.
Chicane — Chicane (Ralentisseur ; mal signalée). Une chicane doit rester visible de loin, éclairée et lisible, sinon elle surprend et dégrade la sécurité.
Crédit photo © DivertissonsNous